Politiser le renoncement
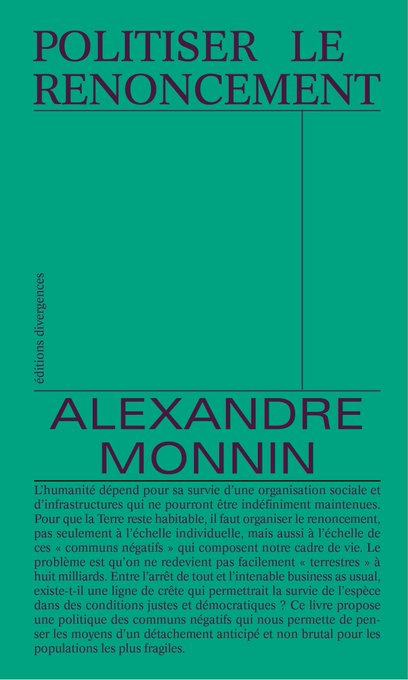
En amont de la publication de son livre « Politiser le renoncement » prévue début 2023, nous relayons un texte du philosophe Alexandre Monnin. Il y est question de pollution de l’air, de covid, d’indifférence face à la mort et à la souffrance de l’autre, de conspirationnisme, d’auto-défense sanitaire et de communisme du soin :
» Sept millions de morts dans le monde chaque année. C’est la conséquence effarante de la pollution de l’air. Comment expliquer qu’un tel bilan suscite si peu de réaction ? Il suffit de mettre en perspective le million trois cent mille morts dus aux accidents de la route, ou les morts par armes à feu (environ deux cent cinquante mille à l’échelle du monde). S’il s’agissait de guerre ou de terrorisme, nul doute que les appels à faire cesser le carnage se multiplieraient. La question généralement posée est « comment comprendre pareille apathie ? ». Mais il n’est pas certain que ce soit la bonne. Surtout au vu des deux années écoulées de pandémie qui nous ont donné à voir que le choix d’une politique de soin n’a rien de naturel. Pour les États d’abord, s’engager dans cette direction « quel qu’en soit le prix », ne va pas de soi.
D’ailleurs, ce temps semble aujourd’hui révolu, et ce d’autant plus que de nouvelles crises et de nouvelles urgences ont succédé dans l’agenda médiatique et politique à la pandémie – qui n’a pourtant pas disparue, la huitième vague monte actuellement sous nos yeux, sans grande surprise et sans guère d’émois non plus. Pour une partie des citoyens, par ailleurs, le coût du soin semble trop lourd : à rebours des mesures prises, les discours exaltant les vivants en bonne santé sachant se passer des vaccins ou encore le droit à la liberté que menacent les mesures de protections des plus faibles témoignent de la prévalence d’un « darwinisme social » appliqué au domaine de la santé, qui a trouvé et trouve encore de nombreux relais.
Il est donc tentant d’établir un parallèle entre les enjeux de qualité de l’air et les leçons du Covid-19, entre un air trop pollué et un virus aéroporté. Au final, comment politiser ces questions et qui doit s’en charger pour éviter que l’indifférence ne gagne la société et que les morts ou le nombre des personnes rendues définitivement vulnérables (asthmatiques, Covids longs, etc.) ne se multiplient en silence ? L’historien Jean-Baptiste Fressoz parle de processus de désinhibitions organisés pour expliquer l’advenue des sociétés modernes et le développement des techniques et de l’industrie. Ne faut-il par voir dans l’insensibilité aux morts résultant de la pandémie ou de la mauvaise qualité de l’air le résultat d’une semblable (dé)politisation ?
Des actions existent dans les deux cas, elles sont souvent les fait d’enquêtrices et d’enquêteurs, académiques ou non. Alors que la pandémie de Covid-19 a pu donner l’image d’un public vulnérable aux séductions des récits conspirationnistes, d’autres collectifs se sont élevés pour poser les prémisses d’un programme d’auto-défense sanitaire. C’est également ce qu’illustrent de nombreuses démarches et des nombreux projets ayant trait à la lutte contre la pollution de l’air. Une auto-défense sanitaire irréductiblement associée à la prise en compte des inégalités socio-économiques.
Une morbidité protéiforme, diffuse et encore sous-estimée
Comme le rappelle Santé publique France, la loi de 1996 définit la pollution de l’air de la manière suivante : « Constitue une pollution atmosphérique […] l’introduction par l’homme, directement ou indirectement, dans l’atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives ».
Une récente série d’étude est venue apporter des connaissances nouvelles à l’étiologie des affections dues à cette pollution. Un article scientifique publié le 28 septembre 2022 établit ainsi que l’exposition aux particules fines inférieures à 2,5 micromètres (µm) augmente le risque de subir un AVC alors que dans le même temps, le dioxyde d’azote (NO2), augmente le risque de développer une maladie cardiovasculaire chez les personnes ayant précédemment fait un AVC. Ces mêmes particules fines sont responsables de cancer du poumon qui se développe en raison de la mutation d’une gêne, un mécanisme mis au jour là encore tout récemment. Le dioxyde d’azote toujours, est responsable de l’apparition de cancers du sein.
Fort de ce constat, et face aux plus de 40 000 à 50 000 morts en France attribuables aux particules fines, l’association les Amis de la Terre a assigné en justice l’État français. Après une première victoire en 2021 (la procédure remontait à 2017) qui s’est soldée par une amende de dix millions d’euros, le rapporteur public a recommandé lors d’une audience le 19 septembre dernier de condamner l’État à payer le double de cette somme, soit vingt millions d’euros.
Lenteur d’autant plus difficile à justifier que le 12 mai 2021, la Commission européenne a adopté un plan d’action destiné à réduire drastiquement les niveaux de pollution à échéance 2030 (EU Action Plan: Towards Zero Pollution for Air, Water and Soil), alors que l’OMS, dans le même temps, abaissait les seuils de référence en matière de pollution de l’air, révisant ses lignes directrices mondiales qui dataient de 2005, « signalant que le dépassement de ces nouveaux seuils relatifs à la qualité de l’air était associé à des risques importants pour la santé, tandis que le respect de ces seuils pourrait sauver des millions de vies ».
De la disparité spatiale aux injustices sociales
La pollution de l’air renvoie à deux sources distinctes mais évidemment reliées : la pollution intérieure, au sein des habitations, et la pollution extérieure. Sur les sept millions de morts annuels, pas moins de 3 200 000 sont dus à la pollution de l’air intérieur selon des chiffres récents de l’OMS (parmi des morts pour l’année 2020, notons que 237 000 étaient des enfants de moins de cinq ans). Là encore, les AVC, cancers du poumon, cardiopathies (ischémiques) ou la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) dominent. Femmes et enfants, qui sont davantage concernés par les tâches ménagères au sein du foyer (cuisine et chauffage, le tout alimenté entre autres par du bois, du charbon de bois, du charbon, des déjections animales, etc.) paient un lourd tribut. Le vernaculaire et tout ce qui rappelle des modes plus anciens de cuisine ou de chauffe se paient hélas au prix fort du point de vue sanitaire.
On aurait cependant tort d’imaginer que ces inégalités s’arrêtent sitôt franchie la porte du foyer. Entre pays du Nord et pays du Sud, elles sont tout autant notables. Mais ces inégalités s’observent également à l’intérieur d’un même pays. Le programme de recherche Equit’Area, développé au sein de l’École des Hautes Études en Santé Publique (EHESP), remontant à 2008, fait office de pionnier dans l’étude de ce phénomène en France. Il visait, comme l’indique son site aujourd’hui accessible via Internet Archive, « à explorer la contribution d’un certain nombre d’expositions environnementales aux inégalités sociales de santé ; inégalités qui ont eu tendance à croître au cours de la dernière décennie ».
Dans la lignée de ce programme pionnier, un travail de recherche récent dû à Pascale Champalaune établit en effet que des différences existent entre les populations touchées par les pollutions extérieures, tant au niveau national que dans les villes. Sa recherche montre qu’au niveau national, les populations les plus aidées et les plus pauvres sont toutes deux plus exposées aux polluants que la classe moyenne. Ceci s’explique par leur présence respective dans les centres-villes. Cependant, à l’échelle des villes cette fois, les quartiers plus favorisés s’avèrent moins exposés aux particules fines que les autres. De même qu’à revenus équivalents, les quartiers peuplés par une proportion plus importante d’immigrés sont également plus touchés par l’exposition aux polluants. Enfin, on constate que les mesures prises pour améliorer la situation bénéficient davantage aux zones favorisées économiquement.
L’Unicef et le réseau action climat ont ainsi mis en évidence que les enfants sont particulièrement touchés par ces pollutions du fait de l’immaturité des leurs organismes et de leur fréquence respiratoire plus élevée, ce qui se traduit notamment par une augmentation de la prévalence de l’asthme (+ 12% chez les enfants entre 2005 et 2012). Quant aux populations les plus pauvres, elles-mêmes cumulent les désavantages : pollutions de l’air extérieur et intérieur plus élevée, moindre capacité à ses déplacer, éloignement des espaces verts, etc. C’est donc une véritable « double peine » qui affecte les enfants les plus pauvres.
Loin d’être un « commun » indifférencié, il y a donc bien une géographie des pollutions qui reflète tantôt des inégalités sociales ou infrastructurelles, tantôt la saisonnalité de certaines activités. Elle est d’ailleurs très loin de se cantonner aux villes. Ainsi, l’association Interqual’air a récemment mis en ligne un outil destiné à partager des fiches « qualité de l’air » pour l’ensemble des communes de la région Centre-Val de Loire.
Les concentrations de polluants relevées sont notamment dues aux grands axes (auto)routiers, en particulier en ce qui concerne le dioxyde d’azote qui touchent particulièrement les zones fortement urbanisées mais aussi celles qui jouxtent ces infrastructures. De même, la pollution est saisonnière, elle dépend, comme nous l’avons vu, du choix des matériaux de chauffe (bois, charbon, coke, etc.), dont certains dégagent d’importantes quantité de particules. Selon les régions, l’usage de ces combustibles ne sera pas le même. Enfin, toujours en zones rurales, l’épandage d’engrais engendre de fortes émissions de particules fines au printemps.
Quand le déni climatique s’allie au soupçon permanent
Faut-il continuer à voir dans ces pollutions des conséquences malheureuses d’activités qui se répètent pourtant d’année en années (l’épandage), d’infrastructures pérenne (les routes) ou des technologies largement répandues (les voitures à moteurs thermiques – dont l’interdiction à la vente a été votée par les eurodéputés le 8 juin 2022), ou ces polluants ne sont-ils pas plutôt les conditions du déploiement et du maintien de ces activités, infrastructures et technologies ? Raison pour laquelle je parle plus volontiers de « communs négatifs » et non d’externalités négatives, qu’un surcroît de bonne volonté (ou d’efficience technique) pourrait aisément faire disparaître.
Quoiqu’il en soit, ces pollutions nécessitent d’être identifiées, de même que les inégalités qu’elles incarnent et qui ne se révèlent qu’au terme de travaux de recherche. L’enquête peut prendre les atours de la science participative. Cependant, deux années de Covid ont renforcé à la fois la défiance vis-à-vis de l’institution scientifique comme du public et celle-ci s’étend aujourd’hui aux institutions qui porte à la connaissance des citoyens et des décideurs le consensus scientifique en matière climatique (en particulier le GIEC mais l’IPBES commence également à être visée par des discours « rassuristes » dans le champ de la biodiversité qui est le sien).
Comme l’écrit le chercheur Baptiste Campion dans la Revue nouvelle : « Il serait sans doute hasardeux de considérer que le climatoscepticisme contemporain ne serait qu’un avatar du complotisme, mais il s’en rapproche clairement et en partage un certain nombre de caractéristiques. Sur le plan formel et structurel, on trouve dans le climatoscepticisme une défiance envers les scientifiques du climat, qui seraient malhonnêtes et cacheraient volontairement la réalité au public pour masquer leurs turpitudes et/ou dans le but d’imposer un modèle politique autoritaire (des règlementations environnementales contraignantes, voire carrément le communisme) ».
À l’heure ou se multiplient les « crises » devenues des permacrises, du renchérissement des prix de l’énergie en Europe à la dégradation du climat, de nouvelles craintes se font jours. Craintes de nouvelles restrictions imposées sans concertations, de rationnement injuste d’interdictions, voire que les principes du « pass » sanitaires soient pérennisés en dehors de son champ premier d’application. On voit ainsi fleurir les suspicions autour d’un « pass énergétique » malgré les démentis, comme d’un « pass climatique », parfois baptisé « passe CO2 ». Le WWF a d’ailleurs repris ce thème avant la présidentielle pour l’imposer au futur impétrant sur un mode d’ailleurs plus symbolique qu’autre chose.
Entre conspirationnisme et inaction de l’État, comment sortir du statu quo ?
Plusieurs publications récentes (Anthony Mansuy Les Dissidents. Une année dans la bulle conspirationniste, 2022, Wu Ming 1, Q comme qomplot : Comment les fantasmes de complots défendent le système, 2022) ont tenté de décortiquer la mécanique conspirationniste et les récits qui l’animent. Or, précisément, ce qui distingue le conspirationnisme de démarches d’enquête participative n’est autre que la place qu’occupent les récits. La recherche de causes et de coupables peuvent parfois sembler proches, elles ne sauraient pour autant se confondre, au contraire.
D’où le paradoxe de la recherche des causes occultes, car il n’est rien de plus téléologiquement orienté que cette démarche. Finalement, elle ne décevra jamais, car aucun démenti ne saurait la mettre véritablement en doute ou en échec. À l’inverse, l’enquête réserve par définition des surprises, elle est pleine d’incertitudes et de nuances. À cet égard, le suivi en direct de vols d’avions privés possédés par des milliardaires ne relève pas vraiment de cette catégorie, mais davantage de la mise en visibilité de faits dont il convient de se demander s’ils sont compatibles avec la situation qui est la nôtre.
Face à l’inaction ou aux lenteurs de l’État, des collectifs s’organisent pour mesurer la qualité de l’air et permettre d’objectiver les inégalités qui président l’exposition aux polluants. Courants aux États-Unis, ces mouvements sont plus récents en Europe. Au Royaume-Uni, il a fallu attendre une étude de 2003 pour que ces questions soient reconnues et, en France l’éveil à cette problématique fut plus tardif encore, le projet Equit’Area, déjà mentionné, ayant démarré en 2008. Le rapport de l’Unicef également cité plus haut rend compte de la lutte en cours des familles des enfants scolarisés au sein du groupe scolaire Anatole-France à Saint-Denis.
L’échangeur Pleyel doit en effet être construit à proximité, ce qui induira quotidiennement le passage de 10 000 à 30 000 véhicules supplémentaires. La cour administrative de Paris (qui reconnaît la réalité des nuisances) et le Conseil d’État ont été saisis. Ironiquement, l’une des mesure prise par la municipalité touche à l’installation de purificateurs d’air, initialement prévus pour le village olympique, dans la cour de récréation de ce groupement scolaire de 700 élèves – une technologie qui figurait au cœur des revendications de plusieurs syndicats et collectifs dans les écoles et les universités afin de lutter contre la propagation du Covid-19.
Démocratie ou redirection écologique ? Un faux dilemme
Si la pandémie a pu affaiblir la vision d’un public actif et engagé dans de réelles enquêtes, reste que des groupes se sont saisis de la question de « l’auto-défense sanitaire ». Finalement, c’est bien cette question qui anime également les associations, chercheurs et citoyens engagés dans la lutte contre la pollution de l’air. Un tel cadrage semble plus fidèle à leurs intentions que celui, plus neutre, moins revendicatif, de la science participative.
Bien loin du conspirationniste qui s’est exprimé à l’extrême-droite comme à l’extrême-gauche parfois, le collectif Cabrioles en appelait ainsi, en janvier 2022, à « faire exister, dans nos villages et nos quartiers, des formes ouvertes de communauté, mues par l’attention portée à la vulnérabilité. Un communisme du soin ».
Face aux communs négatifs dont nous héritons, qu’ils soient liés à la pandémie ou au franchissement des limites planétaires (et ces enjeux sont tout sauf étanches), c’est sans doute la seule stratégie collective digne de ce nom aujourd’hui. Elle passe par le soutien aux enquêtes que mènent les acteurs impliqués. Ce sont ces enquêtes et les revendications qui en découlent qui actualisent les potentialités d’une démocratie vivante et le combat pour la justice (sociale, sanitaire, environnementale).
Loin de s’opposer au temps de l’urgence, ces études, ces alertes et le travail d’enquête qui en découle, anticipent des évolutions qui tardent à se concrétiser. Il faut donc en finir avec le faux dilemme qui oppose, sans nuance, la démocratie (radicale, celle des communs et de l’autodéfense sanitaire), et le climat ou la santé commune. Les publics impliqués ne sont pas en retard sur la technocratie : ils anticipent très largement la décision publique et ont vocation également à l’orienter pour que les mesures prises ne soit ni injustes ni imposées. Le travail des institutions est aussi de se faire les relais de ces acteurs. Ignorer leurs alertes et leurs prescriptions se paie et paiera de plus en plus d’un prix insupportable. »
